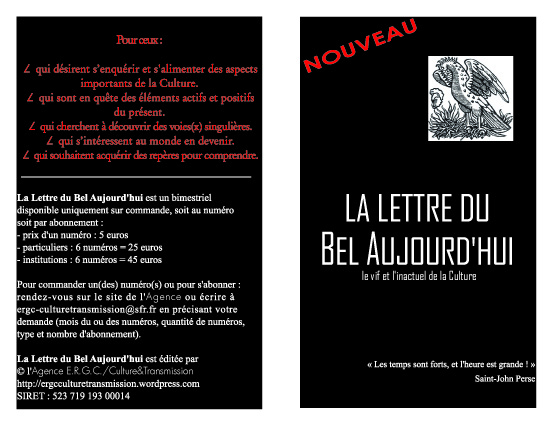La Demeure du Chaos
Publié : 22 août 2012 Classé dans : Quête spirituelle Poster un commentaireLa Demeure du Chaos (DDC), « une des aventures artistiques les plus fortes du XXIe siècle » selon le New York Times, n’est pas simplement un lieu, c’est aussi et peut-être surtout une expérience, voire même une épreuve, en tout cas une mise à l’épreuve de ce que nous sommes et de ce qu’est le monde contemporain. La Demeure du Chaos s’impose au curieux, au visiteur, à l’adepte et à l’initié comme un labyrinthe entremêlant organiquement dimension esthétique et dimension spirituelle, actualité et traditions, réel et virtuel, local et global, « monde physique et celui des idées » (Thierry Ehrmann). Il y a ce qui se voit mais aussi ce qui ne se voit pas, les faits et le sens, l’histoire et la métahistoire, l’épaisseur, la résistance, l’opacité mais aussi le subtil, le fluide et le lumineux. Il y a la chair vive. Le corps, les affects et l’esprit sont ensembles mobilisés ─ tout au moins pour ceux qui sont disponibles ─ bien avant ─ non seulement aux alentours du site géographique mais aussi déjà en vue du site numérique ─ de pénétrer dans son antre. La Demeure du Chaos est située dans le village de Saint-Romain-au-Mont-d’Or, à proximité de Lyon.
La Demeure du Chaos est hybride, protéiforme et bouscule les normes comme les repères, les espaces physiques comme les espaces mentaux. Elle défait les cloisonnements. Elle est à la fois lieu d’exposition (géré par le Musée de l’Organe, entrée libre et gratuite), résidence d’artistes, laboratoire artistique (sur le modèle de la Factory de Warhol), creuset alchimique (placée sous « l’Esprit de la Salamandre »), foyer d’habitation et siège social du Groupe Serveur (premier en Europe des banques de données sur Internet) ainsi que de sa filiale la plus importante : Artprice (leader mondial de l’information sur le marché de l’art).
Proposition singulière dans le paysage artistique et intellectuel français, la Demeure du Chaos, enfantée le 09/12/1999 par Thierry Ehrmann et animée depuis par lui, est en quelque sorte le témoignage à vif de la rencontre et de l’affrontement de la Salamandre avec le Chaos. La Salamandre, parente ignée du Phénix, représente, d’après Paracelse et Fulcanelli ─ ce dernier est le grand inspirateur, avec son disciple Eugène Canseliet, de Thierry Ehrmann ─ le feu élémentaire et spirituel de la Nature, principe alchimique fondamental. Elle constitue le symbole de la Demeure du Chaos. La Salamandre combat, au travers d’un travail spagyrique de destruction-création et de transmutation, non seulement la noirceur et la confusion du monde contemporain, cet âge babélien ou âge du Kali Yuga, mais aussi celles que chaque être individuel porte en lui. Les armes qu’invente Thierry Ehrmann, adepte de la « voie sèche », ou qu’il trouve à sa disposition pour édifier et activer sa « machine de guerre » qu’est la Demeure du Chaos sont : le réseau Internet, sa communauté d’affinités électives, les œuvres d’art (peintures, sculptures et performances), les traditions sacrées, les symboles, les concepts, les images, les archétypes, les récits, les prophétie. La métoposcopie. L’eschatologie, l’anagogie.
Selon une vision ni optimiste ni pessimiste du cours des choses, nous pouvons voir en ce Chaos ─ à la fois subi et sublimé par l’Œuvre ─ la représentation du solve, d’où sortira (coagula) un ordre et un souffle nouveaux. Toujours selon cette vision alchimique des choses, notre présent peut être conçu comme ce moment transitionnel qu’est l’Œuvre au noir, état par lequel doit passer la civilisation occidentale et ce « XXIe siècle tragique et somptueux » (Ehrmann) pour se régénérer.
Thierry Ehrmann, son fondateur donc, synthétise dans et par sa vie ─ de façon alchimique, selon lui ─ les activités de chef d’entreprise performant et millionnaire, de collectionneur avertit mais aussi de plasticien-sculpteur prolixe et performeur. Il affirme que son Grand Œuvre qu’est la Demeure du Chaos relève d’une « ambition humaniste » inspirée par la Renaissance européenne et consistant à diffuser la connaissance. Mais de quel humanisme, de quelle conception de l’être humain s’agit-il quand on sait qu’il s’intéresse particulièrement à l’idée de « mutants » et qu’il propose le terme « humanoïté » ? Et à quelle Loi (Thémis) ─ l’autre pôle indispensable face au Chaos ─ obéit cette « ambition » ?
Cette tentative de constitution d’une Œuvre d’art totale à partir de quoi expérimenter le « champ des possibles » et vivre une forme de rédemption, car il s’agit bien ici de cela, est en réalité difficile à décrire car elle implique, de façon très intime et intriquée, le visible et l’invisible. Une chose est sûre, elle ne laisse pas indifférent et peut même parfois, en raison des actes radicaux de « déconstruction » qu’elle met en œuvre (sur l’architecture ─ le site a un aspect post-apocalyptique[1], sur le corps, sur les identités, sur les idées), notamment au cours des performances qui sont réalisées ─ proches pour certaines des gestes de l’Actionnisme viennois, heurter et choquer les sensibilités et les convictions[2].
Work in progress…
– http://www.demeureduchaos.org (site officiel)
– Fulcanelli :
- Le Mystère des Cathédrales et l’interprétation ésotérique des symboles hermétiques du Grand-Œuvre. Préface de E. Canseliet, F. C. H. Ouvrage illustré de 36 planches d’après les dessins de Julien Champagne, Paris, Jean Schemit, 1926, in-8, 150 p. Dernière réédition : Société nouvelle des Éditions Pauvert, Paris, 2002, 250 p.
- Les Demeures philosophales et le Symbolisme hermétique dans ses rapports avec l’art sacré et l’ésotérisme du Grand-Œuvre. Préface de Eugène Canseliet, F. C. H. Ouvrage illustré de 40 planches, d’après les dessins de Julien Champagne, Paris, Jean Schemit, 1930. (22 novembre.), In-8, XI-351 p. [1823]. Dernière réédition : Société nouvelle des Éditions Pauvert, Paris, 2001, 2 volumes (470 et 390 p.).
[1] La transformation progressive des bâtiments de la demeure initiale, ancien relais de poste établi sur les ruines d’un temple protestant, conséquemment à 10 ans d’interventions artistiques vaut à Thierry Ehrmann et au Musée de l’Organe d’être poursuivis en justice pour non respect des normes urbaines et architecturales. L’affaire n’est pas encore réglée. Voir le site.
[2] Chaque « Borderline Biennal » est réservée à un public adulte et averti.
Le livre numérique et la culturomique
Publié : 22 août 2012 Classé dans : Culture numérique Poster un commentaireIl n’est jamais superflu ou gratuit de rappeler les rapports étroits et dynamiques qui existent entre les livres et la culture. Les livres recueillent, transmettent et activent la culture, ils en sont le médium mais aussi l’indice ; ils fonctionnent comme des phares à occultation, des centres nerveux, des chambres d’écho, des nœuds d’articulation et des facteurs de germination. Aussi, de la même façon que les livres portent et transportent la culture, cette dernière, entendue aussi bien comme processus que comme concrétion spatiotemporelle de ce processus, est aujourd’hui encore inconcevable sans les livres. Les premiers ouvrent la seconde et celle-ci, à son tour, doit s’ouvrir pour laisser la place à ceux-là. Ils doivent donc se comprendre mutuellement.
Dans son rapport au livre notre époque est ambivalente : d’un côté elle démultiplie la présence physique des livres imprimés, de l’autre elle accélère la dématérialisation des livres en les numérisant. Une inquiétude biface, pas forcément répandue hors des milieux artistiques, intellectuels et culturels, est née de cette situation ; son objet est double : d’une part, la disparition du livre physique au profit du livre virtuel, d’autre part, la neutralisation du livre par sa prolifération. La numérisation et l’entropie seraient donc deux phénomènes menaçant le livre, aussi bien son corps que son esprit, son « aura », c’est-à-dire, plus précisément encore, son rapport vivant, rayonnant et fécond aux êtres, et donc à la culture. Le livre et le numérique ne feraient-ils pas bon ménage ?
Nous ne nous attacherons pas ici à l’évidente et aveugle massification de l’offre annuelle de livres ni aux raisons et à la légitimité de l’inquiétude évoquée mais à deux faits convergents liés à la numérisation des ouvrages. Le premier est le lancement en décembre 2010, après plusieurs mois de retard, de la librairie en ligne de Google : Google eBooks Store. Le nombre de livres scannés par cette société depuis 2004 s’élève aujourd’hui à environ 15 millions, dans 400 langues. Proposant pour le moment plus de 3 millions de livres, dont la majorité libres de droit et accessibles gratuitement, Google eBooks est devenue leader dans ce marché, devant Apple et Amazon. Si l’offre est actuellement limitée aux Etats-Unis ─ Google Livres propose déjà en France des ouvrages en français et en anglais ─, Google eBooks devrait être bientôt disponible en France. Un nombre considérable de livres, des ouvrages anciens et récents, une technologie adaptée à la multiplicité des supports, la synchronisation par rapport aux supports, une facilité de lecture et des tarifs concurrentiels sont autant d’atouts qui laissent à penser que l’ère du livre électronique est ouverte. D’autant que le nombre d’utilisateurs de ce service est en progression constante aux Etats-Unis.
La question, en Europe, et plus particulièrement en France, n’est pas tant celle de savoir si il y a des lecteurs potentiels, car chacun sait que les nouvelles générations, qui utilisent avec plaisir et naturel de nombreux outils électroniques, portables ou non, sont prêtes à jouer le jeu ─ le caractère ludique de la technologie les fascine et les attire mais empêche souvent la prise de distance et la réflexion que nécessitent ces nouveautés ─, que celle qui consiste à se demander si, et quand, les éditeurs vont suivre cette tendance et proposer à la numérisation les livres de leurs auteurs. Affaire d’argent plus que de culture diront certains.
Faut-il alors craindre une intensification, voire un changement de nature de l’entropie et(ou) la prochaine disparition du livre papier ? Il est toujours sain de se poser la question si l’on est capable de surmonter les a priori. Si ce type de patrimoine possède une valeur inestimable, cette valeur n’a pourtant de sens et de portée que par rapport à ceux qui en héritent et se l’approprient, plus justement par rapport à la qualité de la démarche de l’héritier, c’est-à-dire par rapport à la culture qui l’anime. Rappelons par ailleurs qu’avec les nouvelles technologies de la transmission et de la communication, le medium devient aussi le message et que les outils électroniques utilisés sont soumis à des logiques de fonctionnement et d’usage qui déterminent le rapport de l’être humain à son environnement, ici l’environnement symbolique. Mais cela était déjà le cas avec l’invention de l’imprimerie. A autres temps, autres défis et autres épreuves, sans doute plus amples et plus intenses aujourd’hui.
Le second fait est d’une tonalité nettement plus optimiste. Un groupe de chercheurs de l’université de Harvard, dont le français Jean-Baptiste Michel, considère que la numérisation des livres est une possibilité nouvelle de recherche et d’étude offerte aux sciences humaines et sociales. Cette équipe, associée notamment à l’équipe de Google Books, a publié début décembre 2010 dans la prestigieuse revue américaine Science (en ligne) un article présentant une nouvelle méthode de mise à jour et de repérage des évolutions de la société et des langues à partir de l’analyse du corpus de livres disponibles en numérique ─ plus particulièrement celui fournit par Google.
Cette méthode inédite, à la base de laquelle se trouve un logiciel capable de repérer des occurrences lexicales, a été baptisée « culturomics » (« culturomique » en français) par ces chercheurs. Ce néologisme discutable est en réalité le résultat de la contraction de « culture » et de « génomique ». L’apparition, les modifications, le type et la fréquence d’utilisation mais aussi l’occultation temporaire ou la disparition définitive d’un mot dans une langue sont effectivement des indicateurs non négligeables qui nous en disent long ─ peut-être trop parfois, mais aussi peut-être pas assez, c’est tout le problème de l’interprétation ─ sur la langue en question et donc, de surcroît, sur la société et la civilisation où elle se manifeste. Bien qu’il faille rester prudent quant à sa valeur heuristique, suspendue à la vérification de la validité de ses critères épistémologiques et à l’approbation des instances scientifiques concernées, et malgré le fait qu’elle opère en arrachant les mots de leur contexte textuel, nous entrevoyons pourtant déjà sans difficulté ce que cette nouvelle approche pourrait apporter à certaines disciplines comme l’histoire, la linguistique et la sociologie.
Cette méthode est donc le fruit de l’application de ces opérations informatiques que sont la numérisation et le calcul aux mots d’une langue, autrement dit, si l’on remonte plus en amont jusqu’à la base du processus, de la rencontre active des chiffres et des lettres. En indiquant cela nous n’insinuons nullement que ce type d’investigation puisse avoir une parenté avec ou déboucher sur une science numérale sacrée, comme par exemple la guématrie. Néanmoins, et là nous abordons des contrées situées non seulement hors des cadres scientifiques mais aussi par delà le sens commun, la recherche des occurrences et des récurrences d’un mot dans un texte ─ dans certains textes particuliers en tous cas ─ à partir de ses constituants ultimes n’est pas sans laisser penser à la possibilité ─ que d’aucuns ne manquerons sûrement pas d’explorer ─ de découvrir des séquences et des séries[1] ouvrant à des interprétations plus ou moins fondées. De plus, en faisant référence à la génomique, les fondateurs de cette nouvelle discipline ont-ils voulu par ce biais évoquer une forme particulière de quête des constituants premiers de la culture, voire même d’un code linguistique générique, ce qui, en regard de leur présentation et en l’état actuel de leurs travaux, comme du reste au vu des possibilités de leur outil, n’est encore qu’une pure spéculation de notre part, à la limite du procès d’intention. Que l’on ne nous en tienne pas rigueur.
– http://www.sciencemag.org/content/early/2010/12/15/science.1199644 (magazine Science en ligne, en anglais).
– http://www.culturomics.org (site de l’équipe du Cultural Observatory qui propose notamment à chacun d’utiliser leur moteur de recherche pour découvrir les occurrences d’un terme dans le corpus de livres de Google Books allant de 1800 à 2000, en anglais).
[1] Voir le film de Π (Pi).
L’UNIVERSITÉ INTÉGRALE
Publié : 16 février 2012 Classé dans : Recherche collective Poster un commentaireNotre époque est tournée vers la récapitulation et la synthèse (le coagula après le solve ?). Les essais et les propositions d’unification des savoirs, issus de nombreux domaines et cherchant à relier différents champs et(ou) méthodes de connaissance, ne manquent pas. Le projet porté par l’Université Intégrale s’inscrit dans cette tendance. Cette « université », association loi 1901, a été fondée le 29 février 2008 à Paris par Michel Saloff Coste, peintre, photographe, cinéaste, écrivain, enseignant et consultant. En fait d’université (référence à l’universalité), il s’agit surtout d’une structure organisant ponctuellement des journées de réflexion ainsi que des « soirées des amis » ouvertes à tous. Parmi les intervenants de ces rencontres citons, entre autres, le sociologue Edgar Morin et le prospectiviste Thierry Gaudin.
L’Université Intégrale est une émanation du Club de Budapest France, association internationale ayant pour objectif l’instauration d’une nouvelle « conscience planétaire », c’est-à-dire d’une conscience culturelle globale basée sur une nouvelle éthique et une nouvelle manière de penser. La présidente de ce Club, Carine Dartiguepeyrou, prend une part très active dans l’organisation et l’animation de l’Université Intégrale. Quant à Michel Saloff Coste, il est aussi l’un des cofondateurs du Club de Budapest.
L’Université Intégrale essaie d’allier les différentes dimensions de la recherche, de la pratique et de l’expérimentation. On ne peut pas encore parler à proprement dit d’enseignement pour cette « université ». Soulignons par ailleurs qu’il ne s’agit nullement de quelque émanation particulière de la vague « New Age » ni d’une proposition supplémentaire de développement personnel ou de PNL. Quant à l’idée émise par Carine Dartiguepeyrou de mettre en place un Comité de sages pilotant les activités et les objectifs de l’Université, elle ne semble pas pour le moment avoir été concrétisée.
Le concept directeur de l’Université Intégrale est « l’approche intégrale ». Il se situe dans le droit fil des initiatives ─ interdisciplinarité, transdisciplinarité, « nouvel esprit scientifique », « nouvel esprit anthropologique », pensée de la complexité, etc. ─ prônant une refondation épistémologique des modes de pensée dans un sens systémique et holistique. Cet appel à une nouvelle façon d’appréhender le monde contemporain correspond, selon ses initiateurs , à la nécessité de s’adapter aux mutations profondes et diffuses qui le secouent, notamment la présence croissante des technologies ainsi que la globalisation des échanges et de la communication. L’ « approche intégrale », signale Michel Saloff Coste, doit s’appuyer « sur l’ensemble des sciences et connaissances existantes, modernes et traditionnelles, occidentales et orientales, scientifiques, artistiques et spirituelles… ». Projet ambitieux s’il en est dont le risque principal demeure tout de même l’édification d’un syncrétisme formel sans assise ni profondeur.
Les champs et les objets d’étude de l’Université Intégrale sont puisés essentiellement dans quelques grands domaines : le social, l’économique, le politique, le spirituel, l’art et l’écologie. L’entreprise, son organisation, est un sujet qui semble lui tenir particulièrement à cœur. Les principaux penseurs qui lui servent de référence sont : Rudolf Steiner, Sri Aurobindo, Pierre Teilhard de Chardin, Edgar Morin, Ervin Laszlo (fondateur du Club de Budapest), Ken Wilber, Rupert Sheldrake.
Il s’agit là encore d’un work in progress.
– http://www.universite-integrale.org (site officiel)
– http://clubdebudapest.org (site officiel Club de Budapest France)
– http://www.humains-associes.org (site créé par le Club de Budapest contenant notamment l’intégralité des numéros 6, 7 et 8 de la Revue Intemporelle : Gilbert Durand, Jean-Pierre Luminet, Jean Baudrillard, Michel Cassé, Jean Staune…)
Mario Vargas Llosa et la fin d’un monde
Publié : 16 février 2012 Classé dans : Littérature Poster un commentaireLa guerre de la fin du monde
Ou l’impossible réalisation de la Cité de Dieu sur Terre
Il ne s’agit pas, en présentant ce livre, de sacrifier à la tendance des prix littéraires, fut-il le prix Nobel de Littérature obtenu par son auteur en fin d’année 2010, mais de mettre en avant, à cette occasion, un texte porteur d’une indéniable qualité, aussi bien littéraire que spirituelle. Ce livre dense (plus de 500 pages dans la version NRF) fut publié pour la première fois en français en 1983.
La guerre de la fin du monde est en premier lieu l’histoire d’un homme, Antonio Vicente Mendes Maciel, dit Antonio le Conseiller, homme ivre de Dieu, prêcheur et prédicateur itinérant, charismatique prophète mystique de la fin du monde et ennemi de la nouvelle République. Il est celui à partir et autour de qui tous les événements de ce livre vont s’enclencher et s’enchaîner, tous les êtres de ce récit (disciples, sympathisants, opposants) vont se retrouver aspirés ─ et pour certains inspirés ─ et emportés dans une folle course et un tragique destin. Aucun personnage ne sortira indemne de ce drame. C’est donc l’histoire d’Antonio le Conseiller, de sa parole messianique, mais aussi de tous ceux (bandits, criminels, paysans, bergers, petits commerçants, gueux, prostituées, infirmes, êtres meurtris et laissés-pour-compte ; anciens esclaves noirs, amérindiens, métis) qui, à sa suite, avec et autour de lui, vont fonder envers et contre tous, dans le sertão (province de Bahia), une société et une ville aux allures de phalanstère mystique chrétien : la « Commune libre de Canudos », qui accueillera jusqu’à 30 000 personnes.
Mais c’est aussi l’histoire de ceux (gouvernement, militaires, propriétaire terrien, politiques ; républicains, monarchiques) qui, pour des intérêts différents et parfois divergents, vont s’opposer à cette communauté subversive et la combattre avec violence. C’est encore l’histoire de la résistance acharnée de Canudos (qui durera près de deux ans [1896-1897] et mettra en déroute quatre expéditions militaires) et de son anéantissement (entre 15 000 et 25 000 morts). C’est enfin l’histoire de deux hommes, de deux témoins : l’un, Galileo Gall, anarchiste révolutionnaire et phrénologue, partisan enthousiaste souhaitant désespérément rejoindre ceux qu’il perçoit comme des « combattants de la liberté » mais n’y parvenant pas ; l’autre, personnage sans nom, désigné comme « le journaliste myope » ─ sans doute l’incarnation d’Euclides da Cunha, prenant directement part aux événements, notamment à la dernière campagne militaire, sans donner l’impression de prendre parti.
La guerre de la fin du monde n’est donc pas seulement la transposition, sous forme d’un récit romancé aux accents épiques parfois teintés d’un certain lyrisme, d’un fait et d’un moment historiques particuliers du Brésil (le passage de l’Empire à la République dans les années 1890 mais surtout la guerre menée par le pays et l’État brésilien contre les femmes et les hommes de Canudos) en même temps que d’une situation socioculturel spécifique (la pauvreté, les humiliations et les difficiles conditions de vie du nord-est brésilien, le Sébastianisme mais aussi les rapports étroits et complexes qui ont existé et existent encore, en Amérique du Sud, entre les pouvoirs politiques et économiques et les pouvoirs religieux, entre le peuple des « damnés de la terre » et les croyances religieuses) mais, à partir de ce contexte (peut-être prétexte) et sous différents angles (différents point de vue de narration), la description circonstancielle, sensible, subjective et dramatique du devenir d’une situation humaine singulière ayant fait irruption dans l’Histoire, bousculant son cours, déstabilisant État et société et bouleversant radicalement l’âme et la vie de très nombreux individus.
L’histoire que nous transmet Mario Vargas Llosa dépasse donc le simple cadre historique et géographique du continent sud-américain ; elle possède une réelle dimension universelle. L’écrivain péruvien nous parle d’un élan humain hors norme et spontané, de ses manifestations et de ses effets, à la fois sur le plan collectif et sur le plan individuel. Canudos, bien loin des théologies de la libération et qui n’a rien de la Commune de Paris ─ toute proportion gardée, ce mouvement serait plus proche de l’histoire de Montségur, a ceci de particulier que ce qui rassemble, cimente, porte, transporte et transfigure les femmes et les hommes de cette aventure communautaire a à voir avec Dieu et le religieux, en tout cas la transcendance.
Au fond, pour reprendre les paroles du personnage journaliste, « Canudos n’est pas une histoire, mais un arbre d’histoires », celles des individus impliqués dans ce tourbillon collectif devenu fait historique majeur pour le Brésil. Des histoires où, au cœur des aveuglements réciproques et des tensions qui se font jour entre traditions et modernité, foi et savoir, progrès positiviste et conservation monarchique, civilisation et obscurantisme, élite et peuple, s’expriment et se manifestent le désir, la foi, la folie, l’amour, l’espérance, la trahison, la fidélité, le salut, la vanité, la solitude, la rédemption, l’orgueil, le sacrifice, l’ambition, la renaissance, la fraternité, la haine, la joie, la nostalgie, la mort, le courage. La « fin du monde » dont il est question c’est en réalité plusieurs choses à la fois : la fin d’une époque particulière, l’impossibilité de la Cité de Dieu sur terre, l’apocalypse des temps modernes mais aussi les différentes apocalypses (bouleversements intérieurs et révélations personnelles) auxquelles sont soumis les protagonistes.
– La guerre de la fin du monde, Mario Vargas Llosa, nrf, Gallimard, 1983.
Le même ouvrage, Folio, Gallimard, 1987.
– Hautes terres (la guerre de Canudos), Euclides da Cunha, Métailié, 1993 (classique brésilien [paru en 1901] traduit en français, une histoire non historienne du conflit)
– Le Brésil face à son passé : La guerre de Canudos.
Euclides de Cunha, l’écriture et la fabrique de l’histoire, coordonné par Idelette Muzart-Fonseca Dos Santos et Denis Rolland, L’Harmattan, 2005 (les rapports Histoire et Littérature, faits et interprétations).
Poètes de l’Imaginaire
Publié : 16 février 2012 Classé dans : Littérature Poster un commentaireVoici une anthologie originale et remarquable sortie en septembre 2010 chez l’éditeur Terre de Brume. Cette anthologie propose une sélection exclusive de poèmes. Le lecteur n’y trouvera donc pas de nouvelles ou d’extraits de roman. Originale elle l’est d’abord par son projet de relier le domaine, circonscrit, confidentiel et sacralisé, de la poésie avec celui, protéiforme, perméable et popularisé, de l’Imaginaire, ou, pour reprendre une distinction proposée par Michel Viegnes, professeur de littérature française à l’Université de Fribourg et préfacier du livre, celui de la « haute culture » et celui de la « culture populaire ». Originale elle l’est ensuite par le choix de la période retenue : les XIXe et début du XXe siècles.
Elle est aussi remarquable car elle réunit sur plus de 600 pages nombre des plus grands auteurs (entre autres José-Maria de Heredia, O. W. de Lubicz Milosz, Charles-Marie Leconte de Lisle, Victor Hugo, Albert Samain, Gérard de Nerval, Louise Ackermann, Catulle Mendès, Émile Verhaeren, Paul Verlaine, Charles Baudelaire, Jean Richepin, Henri Cazalis) de cette période, dont certains sont aujourd’hui, en dépit de la qualité de leur œuvre, tombés dans l’oubli. Elle est remarquable enfin parce qu’y est pris le parti, à travers un classement distribuant, sous quatre grands « genres » différenciés (Faërie/Fantasy, Fantaisies & Fantasmagories, Fantastique et Merveilleux scientifiques/Science Fiction), des « formes » et des thèmes littéraires, de mettre en évidence des écritures présentées comme précurseurs dans ce domaine.
L’initiateur du projet, Sylvain Fontaine, s’est donc attaché, à travers cette anthologie, sa présentation, genre par genre, forme par forme, thème par thème, mais aussi les notes et le lexique qu’il fournit, à mettre en évidence des origines, des influences et des filiations, en tout cas l’existence de liens (inspirations, thèmes, climats, sources, figures) entre les auteurs d’une époque où les classifications étaient encore balbutiantes et les temps présents où nombres de catégories esthétiques imposent des distributions strictes.
A côté de la beauté noire et rouge, aurorale et crépusculaire, spectrale et lyrique, lunaire et solaire qui émane de ces poèmes, en supplément de la rêverie, de l’évasion, du trouble, des émotions complexes mais aussi du sentiment d’étrangeté et de joie que provoque leur lecture, cette plongée dans la poésie du fantastique, de la fantasy et de la science-fiction au XIXe siècle révèle aussi, pour nous qui sommes engagés dans le XXIe siècle, les aspirations, les nostalgies, les positions et les réactions d’hommes et de femmes qui, en une période où s’imposent, avec rapidité et sans nuances, l’industrie, la science et la technique, demeurent épris d’enchantements et de merveilleux, de mythes, de contes et de légendes, d’ailleurs et d’inconnu. Leurs visions, leurs pensées et leurs images sont suscitées, constituent et révèlent à la fois un Imaginaire qui a trouvé à ce moment là dans la poésie une terre vive de refuge et de mise en œuvre. Parions que cet Imaginaire, aujourd’hui plus que jamais asséché et menacé, toujours renaîtra de ses cendres. Une part de nous est en fraternité éternelle avec ces poètes de l’Imaginaire. Nourrissons-nous de leurs témoignages.
– Poètes de l’Imaginaire, Anthologie proposée par Sylvain Fontaine, Terre de Brume, 2010.
Les Éditions Camion Blanc
Publié : 16 février 2012 Classé dans : Editeurs Poster un commentaireLes Éditions Camion Blanc, fondées par Sébastien Raizer et Fabrice Revolon et à l’origine de la collection « Camion Noir », seraient-elles le Janus bi-front de l’édition française ? D’un côté, sous l’enseigne « Camion blanc », elles se présentent comme « l’éditeur qui véhicule le rock » ; de l’autre, avec la griffe « Camion noir », son autre intime, elles s’affichent comme « l’éditeur qui véhicule le souffre ». D’un côté, les arcanes, les abîmes, les affres et les visages du rock, de l’autre, les manifestations différenciées et dérangeantes de la zone d’ombre de la culture occidentale, essentiellement depuis le XXe siècle. Mais la séparation-distinction n’est en réalité qu’apparente, tout au moins peut-on dire qu’elle n’est pas si hermétique que cela et qu’il y a perméabilité, porosité entre les deux entités, un peu comme le partage que présente le symbole du Yin-Yang. Il y a en effet du « Camion noir » (mouvements gothiques, mouvements païens, la scène hardcore,) chez « Camion blanc », comme il y a du « Camion blanc » (black metal, néofolk, rock’n’roll) chez « Camion noir ». Cela revient à dire, et l’on s’en doutait un peu, que le rock est l’élément qui fait lien et passerelle entre les deux.
Cet éditeur basé en Lorraine, à Rosières-en-Haye, publie aussi bien des essais, des entretiens, des confessions, des anthologies, des romans que des traductions. Nombre de textes sont inédits et pour certains difficiles à trouver ailleurs. On découvre en particulier quelques livres cultes comme Au delà de l’avenue D, de Philippe Marcadé, le Magia sexualis, de P. B. Randolph, ou encore Le Livre de la Loi, d’Aleister Crowley.
Les thèmes abordés par « Camion blanc », dont le catalogue contient environ 115 titres, sont, à côté des nombreuses analyses de la vie et de la musique de certaines idoles rock (entre autres, Johnny Cash, Patti Smith, Iggy Pop, John Lennon, Nick Drake, Bon Scott, Ian Curtis, Syd Barrett, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Pascal Comelade, Sid Vicious, Serge Gainsbourg, Ozzy Osbourne, Noir Désir, The Beach Boys, Kraftwerk, The Velvet Underground, Led Zeppelin, Nine Inch Nails, Metallica, Tool, The Yardbirds), des anthologies (Rock progressif, Metal), des études de styles (New Wave, Punk, Musique industrielle), des études thématiques diverses (références littéraires et cinématographiques dans la musique, les chansons à guitare, l’histoire des DJ, le gangsta rap, les dérives du rock) mais aussi la présentation de quelques « medias » (le label Sordide Sentimental, Slayer Mag, le fanzine Atem).
Quant à « Camion noir », ses 54 titres proposent de pénétrer dans des territoires aussi divers que le monde des sorcières, le cinéma « maléfique » de David Lynch, l’univers des vampires, les faces occultes du nazisme, l’Église de Satan d’Anton LaVey, la magie noire, les annonciateurs d’apocalypses, le traité Hagakure ou encore les tueurs en série. On trouve aussi des ouvrages présentant le parcours et la personnalité de certains personnages plus ou moins connus mais ayant tous défrayé la chronique : l’énigmatique réalisateur J. X. Williams, l’actrice porno mineur Traci Lords, la comtesse tueuse en série Erzsebeth Báthory, le gourou meurtrier Charles Manson, le bluesman « diabolique » Robert Johnson ou celui qui fut surnommé « le Raspoutine de Himmler », Karl Maria Wiligut.
Au vu de toutes ces thématiques ne concluons pas trop vite à une fascination pour le morbide et la noirceur, à un désir de provocation ou de sensationnalisme. Les textes sont généralement sérieux et de qualité. Il s’agit plutôt pour l’éditeur de faire découvrir tout un pan, refoulé ou méconnu, de la culture occidentale. L’important est toujours de s’informer pour comprendre. Le pari de cette maison d’édition est courageux.
– http://www.camionnoir.com (site officiel)
– http://www.camionblanc.com (site officiel)
Avant le Big Bang
Publié : 16 février 2012 Classé dans : Sciences Poster un commentaireL’Univers sans commencement ni fin ?
Le 30 juin 2001 la NASA lançait la sonde/satellite WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) dans le cadre d’une mission ayant pour objectif de mesurer avec précision ce que les scientifiques appellent le « rayonnement fossile » (ou « rayonnement cosmologique », ou encore « fond diffus cosmologique ») de l’Univers, ce résidu cosmologique des origines. Cette radiation électromagnétique omniprésente dans l’univers, provenant de toutes les directions du ciel et datant d’environ 380 000 ans après le Big Bang ─ selon le modèle de la cosmologie standard ─ est en quelque sorte, selon les astrophysiciens, un témoignage fiable de l’état physique dans lequel se trouvait l’Univers à un moment relativement proche ─ compte tenu des 13,75 milliards d’années dont il est censé être âgé ─ de son état initial. Sachant que la connaissance des conditions initiales de l’Univers est capitale pour comprendre et modéliser son évolution, on se rend compte de l’importance d’une telle mission. Le succès fut au rendez-vous et tous les astrophysiciens et cosmologistes purent dès lors se pencher, et se penchent encore, sur les cartes du ciel micro-onde fournis par WMAP. Sur ces cartes figurent des données sur les fluctuations de température du rayonnement thermique cosmologique ainsi que sur sa polarisation.
Vahe. G. Gurzadyan (Yerevan Physics Institute and Yerevan State University, Yerevan, 0036, Arménie) est astrophysicien et cosmologiste. Il a lui-même étudié sept ans de données récoltées par WMAP ainsi que les résultats rapportés par le ballon stratosphérique d’observation américain (expérience BOOMERanG ayant eu lieu en Antarctique en 1998 et 2003) chargé lui aussi de prendre les mesures du « rayonnement fossile ». Les données qu’il a recueillies et analysées paraissent corroborer un modèle cosmologique particulier faisant concurrence au modèle cosmologique standard, dit « modèle inflationniste », aujourd’hui très majoritairement accepté en raison de sa compatibilité avec les données de diverses expériences. Le modèle ainsi crédité par l’observation est celui proposé par le mathématicien et physicien britannique de renommée mondiale Roger Penrose (enseignant à Oxford) sous le nom de Cosmologie cyclique conforme (CCC).
Dans un article cosigné avec Gurzadyan et daté du mois de novembre 2010, Penrose présente les éléments (des cercles concentriques présents dans la carte micro-onde du ciel) qui, provenant de WMAP et de BOOMERanG, semblent confirmer certaines prédictions contenues dans la CCC, impliquent des fluctuations de températures difficilement explicables par le modèle inflationniste et, surtout, témoignent finalement, à la façon de traces physiques (il s’agit d’ondes gravitationnelles), de l’existence non seulement d’un espace-temps avant le Big Bang mais aussi du caractère cyclique de l’Univers.
Selon le modèle inflationniste, stipulant l’existence d’un Big Bang originaire (ou Singularité initiale) suivi de trois phases : une formidable inflation en un temps extrêmement court (une fraction de seconde), un ralentissement au cours duquel sont apparues planètes et étoiles, et, enfin, une phase d’accélération indéfinie de l’expansion (phase actuelle), l’Univers tendrait progressivement vers un état froid et homogène, synonyme de mort énergétique. Dans le modèle de Penrose, au contraire, notre Univers ne mourrait pas vraiment mais renaîtrait indéfiniment après une ère d’expansion infinie baptisée par lui du nom de « éon ». Si Penrose soutient que l’état physique terminal de ces périodes pourrait être très proche de leur état physique initial, son modèle n’est pas pour autant une manière de ressusciter l’ancien modèle cyclique de l’Univers oscillant (Friedmann) faisant alterner indéfiniment expansion et contraction. Dans le modèle CCC il n’y aurait donc plus un Big Bang mais une série non quantifiable de Big Bang.
Les prises de position cosmologiques de Penrose provoquent, en plus des inévitables débats et réactions qu’elles ne manquent pas de susciter dans le monde de la physique du cosmos, nombre de questions philosophiques et spirituelles. D’autre part, sans faire l’objet d’attaques virulentes ni être le centre de violentes polémiques, comme c’est le cas pour la thèse des frères Bogdanov ─ situation due plus à l’image et au parcours des deux frères qu’au contenu de leur prise de position ─ défendant un « avant le Big Bang », le modèle de la CCC est toutefois sujet à de nombreuses controverses.
En mobilisant le terme « éon », qui signifie aussi bien « ère » qu’« éternité », terme déjà utilisé par les Gnostiques pour désigner les émanations successives issues du Dieu infini et inconnaissable ; en réactualisant, d’une façon certes scientifique, le grand mythème de « l’éternel retour » ; en soulignant une certaine contiguïté des extrêmes (fin et commencement), Roger Penrose, déjà connu pour sa théorie des « trois mondes » (monde matériel, monde de l’esprit et monde des mathématiques proche de celui des Idées platoniciennes, ce dernier directement accessible à l’esprit et fondement du monde physique), prête involontairement le flanc aux jugements critiques de ceux qui veulent voir en lui un « spiritualiste ». Contre les évaluations hâtives et partisanes, peut-être faut-il voir simplement en sa démarche la marque d’un esprit à la fois ouvert, non dogmatique et prêt à bouleverser certains cadres établis, un esprit en résonance avec notre époque de transition propice aux réformes intellectuelles.
– http://fr.arxiv.org/abs/1011.3706 (article de Roger Penrose et V. G. Gurzadyan, en anglais).
– La nature de l’espace et du temps, Stephen Hawking et Roger Penrose, Gallimard, 2003.
– Les deux infinis et l’esprit humain, Roger Penrose, Flammarion, 2011.
– Discours sur l’origine de l’univers, Étienne Klein, Flammarion, 2010. (l’incontournable question des débuts)
– L’univers Chiffonné, Jean – Pierre Luminet, Gallimard, 2005. (sur les formes et le destin de l’univers)
– L’univers en rebond, Avant le big bang, Martin Bojowald, Albin Michel, 2011 (réflexions et hypothèse sur un avant Big Bang).
– Avant le big bang, Igor et Grichka Bogdanov, LGF, 2006. (pour comprendre les enjeux d’une question et se faire une idée de ce qui a pu déclencher la polémique autour des deux frères)
– Avant le Big Bang, le modèle géométrique de la genèse du monde, Richard Sünder, Quintessence, 2004. (avant les Bogdanov)
PHILOSOPHIE NON-STANDARD
Publié : 14 janvier 2012 Classé dans : Philosophie Poster un commentaireNous souhaitons évoquer ici la sortie, fin 2010, du dernier livre de François Laruelle, philosophe, professeur émérite à l’Université de Nanterre et surtout fondateur de la « non-philosophie ». La « non-philosophie », discipline très peu médiatisée et très peu reprise en France, n’est ni une anti-philosophie, ni contre la philosophie ni même un déni de la philosophie mais, d’une part ─ son versant négatif ─, remise en cause de et résistance à la « suffisance » de la philosophie se manifestant à la fois comme autopositionnement absolu et prétention à établir les déterminations du Réel et de l’Homme, et, d’autre part ─ son versant positif ─, tentative de constitution d’une « science de la philosophie » à partir d’un regard bienveillant et mobilisateur tourné vers la science elle-même et non plus la philosophie. La formule complexe et paradoxale ─ la philosophie y est à la fois rejetée et requise ─ proposée par Laruelle qui synthétise la nouvelle positivité inaugurée par la « non-philosophie » et qu’achèvera la philosophie « non-standard » est celle-ci : « l’alliance générique de la science et de la philosophie sous la science ».
La « non-philosophie » n’est pas la porte ouverte à la doxa débridée et elle-même autosuffisante ou aux autres discours prétendant à l’objectivité mais, tout à la fois, exercice de suspens de toute autorité, de toute suffisance et de toute positivité des discours quels qu’ils soient afin d’instaurer une forme de démocratie de la pensée, et recherche d’une méthode rigoureuse aboutissant à la refondation radicale de la philosophie dans un nouveau mode de pensée. Radicale, c’est-à-dire strictement hétérogène à ce qu’a été la philosophie jusqu’à aujourd’hui mais qui fasse cependant du modèle de la philosophie aussi bien un objet, un matériau qu’une occasion.
La philosophie « non-standard » (titre de son livre) représente dans l’œuvre de Laruelle un achèvement, l’achèvement de la philosophie comme l’achèvement de sa propre pensée. L’une des raisons, que nous qualifierons de stratégique, de cette nouvelle et dernière dénomination est, selon celui-ci, qu’elle prête moins à confusion. Il reste néanmoins à lever l’ultime ambiguïté : elle n’est pas une philosophie supplémentaire. À chacun en tout cas d’apprécier. Signalons que la genèse de cette philosophie dernière et première s’est accomplie par étapes ─ quatre au total ─ et s’est nourrie de Marx, de Nietzsche, de Bergson, d’Heidegger, de Husserl, de Freud, de Derrida, de Deleuze, de Lévinas, de Michel Henry, d’Alain Badiou et bien sûr des lectures des grands acteurs scientifiques de la physique quantique. Parce qu’ils ne sont pas allés jusqu’au bout de l’implication immanentiste et ont préservé dans leur conception une certaine dimension transcendantale, Laruelle affirme avoir aujourd’hui en quelque sorte dépassés et achevés tous ces points d’appui, toutes ces références.
C’est donc bien à partir, en prolongement et en aboutissement des enjeux soulevés et assumés par la « non-philosophie » que la philosophie « non-standard », véritable travail d’élaboration d’une méthode originale de pensée, dite « générique », s’est constituée. Il manquait seulement à la « non-philosophie » l’outil permettant d’obtenir ce que Laruelle nomme le « forçage » de la philosophie en vue d’une « science générique de la philosophie ». Cet outil, il l’a trouvé dans une science particulière : la physique quantique. La philosophie « non-standard » est née en effet de la mobilisation particulière de la quantique, de son « noyau rationnel, le quantiel ». La philosophie est devenue dès lors un « objet à quantifier ».
Tâcher de penser quantiquement la philosophie c’est d’abord envisager l’existence de modalités dynamiques microscopiques spécifiques de la pensée, c’est alors passer d’une « physique » macroscopique des systèmes conceptuels et des idéologies, des visions et des conceptions du monde à une « physique » microscopique des phénomènes originairement constituant de la pensée , c’est à dire d’une détermination corpusculaire de la pensée à une « sous-détermination » ondulatoire. C’est ensuite, partir de ce constat, opérer une « dé-numérisation » et une « dé-conceptualisation » de la pensée aboutissant à une « science-sans-nombres ou sans-calcul et sans-transcendantal ». C’est aussi réaliser la « superposition » d’une singularité algébrique : le nombre imaginaire ou complexe et d’un « vécu-sans-sujet » sous une Science Générique. C’est encore constituer, à partir de certaines « manières de raisonner prises de la pensée quantique » (idempotence, superposition, non-commutativité, dualité onde/corpuscule, fonction d’onde, indéterminisme, quart de tour ou spin 1/4, nombre imaginaire, effet tunnel, les paradoxes) un « milieu » d’expérimentation générique, une « Matrice » au sein de laquelle vont entrer en collision différentes « particules de savoir » en vue de découvertes et d’inventions de pensée toujours reconductibles.
C’est, enfin, privilégier le comment sur le pourquoi. La philosophie « non-standard » possède donc une évidente dimension agnostique même si le terme « gnose » est fréquemment employé par Laruelle pour qualifier la prise de conscience salutaire de « l’immanence radicale » où s’origine la pensée. Cet agnosticisme est à la base de la distinction faite entre « absolu » ─ synonyme chez lui d’objectivité, d’en soi, d’identification, d’« Idéal du moi », de double transcendance, de circularité, d’autorité, de sclérose ─ et « radical ».
Est-il possible d’évoquer, de résumer ou de synthétiser un ouvrage tel que celui-là ? Il s’agit de la présentation « non-suffisante » de ce paradigme quantique à l’issue incertaine devant permettre de « renouveler l’accès à la philosophie » et ainsi de la transformer fondamentalement. Sa lecture est particulièrement difficile, en raison en particulier de la densité intellectuelle de la pensée de l’auteur, de « l’usage plus ou moins nouveau des vocabulaires traditionnels », de la mobilisation de matériaux provenant d’une science contemporaine ardue, de la mise en place de principes et de logiques inédits et singuliers mais aussi, nous tenons à le signaler, d’une édition dont la qualité laisse à désirer. L’enjeu est en réalité aussi bien gnoséologique qu’éthique, il s’agit, affirme Laruelle, d’établir, à partir d’une « suffisance » intellectuelle posée comme irrémédiablement impossible à cause de la structure radicalement immanente, virtuelle, ondulatoire, non réflexive, non consciente et générique du penser, une science de l’homme libératrice ─ Laruelle parle même de « salut » ─, démocratique et capable d’invention permanente. Ce que le non-philosophe appelle « l’humanité générique », au sein de laquelle les être humains sont conçus comme des « machines vibrantes », n’est autre que le médium, et non le médiat ou la médiation, devant recueillir, préserver, amplifier et intensifier la grande vibration sous-jacente du monde.
Le « tournant ondulatoire » non philosophique (Kehre) est synonyme, pour son initiateur, de sortie hors de la circularité autoréférentielle et autosuffisante de la philosophie mais aussi hors de toutes les suffisances intellectuelles, politiques et religieuses. Il signifie un changement d’opérateur et de constante : le passage du transcendantal à « l’immanental », c’est-à-dire à l’immanence radicale ou « superposition idempotente ». La science générique de la philosophie qu’il inaugure et qui n’a rien d’une épistémologie, fruit d’une « collision de savoirs » devant ouvrir à d’autres collisions similaires, se présente plus précisément comme découverte et mise en œuvre ─ par un opérateur appelé Étranger et lui-même sous-déterminé par la Matrice ─ d’une nouvelle forme, radicale, unilatérale et « unifaciale » (négation des rapports d’opposition commutatifs sujet/objet, intérieur/extérieur), de décentrement du sujet, de la conscience, de la représentation et de la réflexion : toute identité, toute pensée, toute conception, tout discours thétique et même, au fond, toute expression symbolique, dépendent unilatéralement, d’après Laruelle, d’une dynamique ondulatoire de « dernière instance » définie comme « Sujet générique ». Ce dernier, seul sujet réel, échappe radicalement à toute circularité réflexive, à toute autodétermination et donc à toute thématisation possible ; il est trans-individuel. Nous sommes en présence ─ mais nous ne le sav(i)ons pas ─ d’un processus machinique producteur indéfini de « clones conceptuels » (le Monde, l’Homme, les théories, les idées, les images) à partir duquel toute transcendance, et en particulier les objectivations de nature « corpusculaires », est ramenée « en immanence » comme milieu unique et virtuel. C’est le règne radical de l’Un et du Même immanents et génériques que délivre Laruelle.
Ne s’agit-il pas finalement, avec la philosophie non-standard, de retrouver (à partir des « occasions » qui se présentent comme science et philosophie, deux modes néoténiques de pensée) les fonds actifs de la science et de la philosophie et à partir de là d’amplifier et d’intensifier leurs puissances à partir de cette origine radicale qu’est la Dernière Instance, la matrice dite « générique » ? Ce qu’il faut saluer en cette « utopie micro-philosophique » devant nous libérer « des formes et normes disciplinaires de la pensée » et nous invitant, au travers du concept de « philo-fiction » ou de « science-phiction », à inventer de nouvelles formes et surtout un nouvel usage de la pensée, c’est son originalité, sa cohérence, son amplitude, sa profondeur, son effort transdisciplinaire réel et sa puissance utopique. Deux bémols importants cependant : l’aspiration à une démocratisation du savoir nous semble contredite par l’aridité et la difficulté du texte ; nous ne pouvons nous empêcher de considérer qu’en évacuant la question du « pourquoi » comme celle du « sens », comme du reste celle de leur épreuve personnelle, et en valorisant un savoir impersonnel, cette Science générique laisse la voie à un certain relativisme critique des plus stériles.
– Philosophie non-standard : Générique, quantique, philo-fiction, Kimé, 2010
– http://www.u-paris10.fr/16546219/0/fiche___pagelibre/&RH=depphilo_ensch (page personnelle de François Laruelle depuis le site de l’Université Paris X – Nanterre contenant une importante bibliographie)
– http://www.non-philo.com (pour écouter François Laruelle, site contenant notamment de nombreux cours thématiques)
– http://www.onphi.net/accueil (site de l’Organisation Non-philosophique Internationale)
– http://la-non-philosophie.blogspot.com (blog d’informations et de recherches sur la non-philosophie)
– https://www.philo-fictions.com (site de la revue Philo-Fictions, la revue des non-philosophies)
JUNK
Publié : 12 janvier 2012 Classé dans : Les aspects positifs du Junk Poster un commentaireLA FORTUNE DU JUNK ou la revanche du laissé-pour-compte
« …la vérité ou la nouveauté peuvent éclater à travers l’examen
de ce qui était négligé ou regardé comme insignifiant ! […] Les découvertes essentielles sont souvent sorties des résidus ». François Dagognet
Le terme « junk » nous fait immédiatement penser à celui ou à celle qui consomme fréquemment des drogues dures auxquelles il(elle) est devenu(e) dépendant : le « junkie ». Réalité concrète et violente que celle-ci. Le « junk » c’est en effet la « came », la drogue. Mais le terme, d’origine anglaise, est en réalité bien plus riche en significations et possède aussi une évidente portée symbolique, comme nous le verrons par la suite ; il désigne tout autant le « bric-à-brac », les « vieilleries », la « ferraille », la « camelote », la « pacotille » que le « déchet », le « détritus », le « rejeté », le « résidu », le « rebut », le « dépotoir » ou la « décharge publique ».
Si nous y regardons de plus près, nous nous rendons compte que l’usage d’un tel terme, spécifique à l’époque contemporaine et à ses situations, est lié à trois grands types de choses :
– celles dont on ne veut pas (le rejeté)
– celles dont on ne veut plus (le rebut, le déchet)
– celles qui restent ou résultent d’un usage et sont abandonnées comme telles (le résidu).
« Junk » est donc d’abord un terme qui évoque un rapport aux choses commandé par la volonté et(ou) par l’usage, rapport par ailleurs déterminé par le fonctionnement sélectif, dissociatif, discriminatif et cloisonnant de notre esprit mais aussi par le contexte civilisationnel. La connotation de ce terme demeure cependant toujours négative ou dévalorisante. « Junk » est ainsi en premier lieu un jugement de valeur négatif associé à un produit, toujours passif, de la civilisation contemporaine, principalement occidentale. Il est l’autre nom du déchu, ce qui est sans valeur ni vertu.
Depuis plusieurs dizaines d’années pourtant, ce terme, tout en continuant à désigner ce dont on juge de qualité médiocre (junk culture, junk food, junk bond), indésirable (junk mail, spam), sans utilité (junk DNA) ou porteur de confusion (junk space), a fait l’objet, de la part de certains chercheurs et créateurs, d’un vif intérêt au point de faire de quelques unes des réalités auxquelles il est associé des domaines de recherches ou d’intervention. Les implications qui en résultent ne sont pas sans pertinence et ouvrent parfois des horizons fertiles pour la connaissance, l’œuvre et l’action.
Nous avons choisi de présenter trois de ces démarches particulières qui, pour des motifs très différents, s’intéressent se sont attachées au champ du junk.
On trouve en premier lieu le junk art. Ce courant artistique s’est développé surtout à partir des années 1950, aux Etats-Unis et en Europe. En fonction des lieux et des personnalités on rencontre aussi d’autres appellations : néo-dada, art de l’assemblage, art of the vulgarian, Nouveau réalisme. Il s’agit dans tous les cas, à travers la mobilisation de certains objets emblématiques du quotidien, de faire référence, voire de prôner un retour à la réalité la plus prosaïque, pour la dénoncer ou tout simplement la révéler. S’exprimant plus particulièrement à partir de la récupération et de l’assemblage, ou du collage, en trois dimensions des rebuts et des déchets de la société industrielle et de consommation, le junk art s’affirme essentiellement comme sculpture (junk sculpture). Il est considéré comme une forme particulière d’art populaire. Si Kurt Schwitters et Robert Rauschenberg représentent deux de ses hérauts, ses autres principaux représentants sont, entre autres, César, Arman, John Chamberlain, Daniel Spoerri, Jean Tinguely. Le junk est alors, dans cette perspective, ce qui, déjà là dans l’espace privé et public sous la forme d’une accumulation passive, est transformé par l’artiste au travers d’un processus d’accumulation active et transfigurante.
Même si le concept de junkspace inventé par lui contient une puissante charge critique indéniable, il n’en demeure pas moins, selon nous, que la position de Rem Koolhaas à l’égard de ces « espaces rebuts/résidus » désignés par cette terminaison est, sinon ambiguë, au moins ambivalente.
Parce qu’il existe quelque nuance importante dans sa façon de se rapporter intellectuellement et affectivement au junkspace mais aussi parce que sa démarche d’architecte nous paraît digne d’intérêt, nous avons décidé d’évoquer ici le travail de Rem Koolhaas. Signalons aussi que les éditions Payot viennent de publier trois de ses textes majeurs (Bigness ; Ville générique ; Junkspace) sous la forme d’un recueil intitulé Junkspace. C’est la première fois que ces trois textes sont accessibles en français. Koolhaas est aussi d’actualité en France, et plus particulièrement à Toulouse, où il vient de remporter le concours du futur Parc des expositions situé à Aussonne.
La deuxième approche que nous mettons en évidence est donc relative au domaine de l’architecture. Rem Koolhaas est un architecte et un urbaniste néerlandais. Il enseigne à Harvard. Son travail se distribue aujourd’hui autour de deux structures professionnelles symétriques et complémentaires fondées par lui : l’O. M. A. (Office for Metropolitan Architecture), lancée en 1975 et qui se consacre principalement à la réalisation de projets architecturaux, et l’A. M. O. (Architecture Media Organization), agence créée en 1998 afin de servir de pôle de recherche conceptuelle et de creuset de définition des moyens (symboliques et opérationnels) d’intervention relatifs au devenir des zones et milieux urbains contemporains. Cette dernière est en quelque sorte un laboratoire d’idées.
Ce qui est intéressant chez Koolhaas c’est, d’une part, son apparente volonté de ne pas négliger l’aspect théorique et l’invention conceptuelle, de les rattacher à des problématiques concrètes spécifiques du présent (culture, communication, image, réseau, virtuel), et, d’autre part, sa lecture relativement optimiste ─ que l’on prend parfois pour une allégeance au postmodernisme et au libéralisme ─ et sa façon d’envisager globalement ─ au travers de la mobilisation de diverses disciplines ─ le cours des choses et les mutations du monde contemporain. Koolhaas pense la transition que représente notre époque, et, au sein de celle-ci, le sens et le devenir de l’environnement de l’être humain.
Le terme « junkspace », forgé par Koolhaas et apparu en 2001 dans un ouvrage collectif intitulé Harvard Design School Guide to Shopping, Project on the City 2, Taschen, 2001, et repris dans la revue October, Vol. 100 – « Obsolescence » pp. 175 – 190, 2002, renvoie, selon l’architecte, à ce qui « reste après que la modernisation a effectué son parcours ou, plus précisément, ce qui se coagule au fur et à mesure que la modernisation avance. » Entropie urbaine, confusion esthétique et chaos axiologique sont les traits marquants de ce phénomène.
En réalité le junkspace est polysémique chez Koolhaas et désigne aussi bien ces lieux où se mélangent sans hiérarchie ni code identifiable tous les styles architecturaux, la sédimentation et l’homogénéisation urbaines de la civilisation occidentale moderne, la non-architecture ou le non-urbanisme contemporains, l’essence même du processus de modernisation, la spectacularisation des villes, l’avènement du règne du confort et du plaisir, les espaces inutiles et morts laissés pour compte dans les villes, la circulation permanente et la continuité indéfinie (rendues possibles notamment grâce aux escalators et à l’air conditionné) présentes au sein et entre les zones et bâtiments, la privatisation marchande des espaces publics que la ville globalement façonnée par les logiques et les structures du shopping, c’est-à-dire du commerce et de la consommation.
Junkspace est donc le destin actuel de l’espace urbain et le visage résiduel d’un monde né avec la modernité et soumis à la force aveugle et immanente du désenchantement, de la dépolarisation, de la désidentification, de la babelisation, de la marchandisation, de l’aliénation du désir, de l’uniformisation axiologique, du non-temps et du non-espace. Une question s’impose : le junkspace deviendra-t-il junkyard (la casse, la décharge) où s’enlisera et s’abîmera progressivement l’humanité avec ses productions et ses œuvres ? Mais le junkspace est peut-être aussi l’achèvement, forcément transitoire, le solve contemporain d’un coagula à venir, l’œuvre au noir non pas dérisoire et négligeable mais nécessaire, le passage obligé d’où jaillira une nouvelle alliance, un « nouveau paradigme » (expression utilisée par Koolhass). A la différence de l’exemple précédent, le junk est donc ici, en lui-même, profondément actif, se répandant et répandant partout sa logique et ses fruits.
Des composantes de la ville aux constituants de la vie (du vivant), du générique au génétique, nous passons de l’architecture et de l’urbanisme à la science et à la biologie, notamment moléculaire, domaine où nous rencontrons le troisième exemple d’attrait pour le junk. Peut-être ce passage, cette transition ne sont-ils pas si arbitraires que cela si l’on en croit (http://mirabilia.europa.over-blog.com/article-31642272.html) notamment l’un des chercheurs qui s’est attaché depuis quelques années à essayer de comprendre la nature et le sens d’une partie énigmatique de l’A. D. N., cette partie que la communauté scientifique dans son ensemble a longtemps baptisé de « junkADN ». Dans la bouche des scientifiques ce terme était résolument péjoratif, il signifie « ADN poubelle » et était censé baptiser une partie de l’ADN qui, selon eux, ne sert strictement à rien. Il faut cependant souligner que les choses ont changé et qu’il existe depuis le milieu des années 90, chez les scientifiques eux-mêmes, une tendance à reconnaître le fait que le junkADN possède une réelle fonction, ce qui a pour effet de voir le terme « ADN non codant » se substituer de plus en plus fréquemment à celui de junkADN.
Le chercheur que nous venons d’évoquer, spécialiste des sciences de la communication et enseignant à l’Université de Montréal, se nomme Thierry Bardini. Il est de ceux ─ parmi lesquels nous trouvons, entre autres, et ils sont de plus en plus nombreux, l’anthropologue Jérémy Narby mais aussi le prix Nobel de médecine 1983 Barbara McClintock, qui fut une des premières à postuler que l’« ADN poubelle » puisse avoir une fonction ─ qui questionnent le junkADN et qui pensent que ce territoire biologique recèle des potentialités et des ressources positives inconnues.
A la fin de son texte intitulé Junkspace, Koolhaas se demande si le junkspace ne va pas envahir le corps. Thierry Bardini répond que c’est déjà fait et que cela a lieu en son fond biologique le plus intime et le plus déterminant, au cœur du noyau cellulaire, dans l’ADN même. Mais de quoi est-il question au juste ?
En 1972 Susumu Ohno, chercheur en génétique, invente le terme « Junk DNA » pour désigner environ 95% du génome humain dont on ignore la fonction. Nous savons aujourd’hui que 97% de notre génome, c’est-à-dire de l’ensemble des gènes propres à l’organisme d’un individu, est constitué de « non-gènes » qui ne codent pas et ne participent donc pas à la fabrication des protéines, ces éléments vitaux constitutifs de la structure et du fonctionnement de la matière vivante. Ces « non-gènes » englobent plusieurs types de séquences d’ADN différents. On y inclut à la fois les « introns », les éléments de gènes qui ne sont pas exprimés lors de la synthèse de protéines, des éléments transposables (ou «transposons»), des séquences d’ADN répétées, que par ignorance on suppose parasitaires, se répliquant sans ajouter quoi que ce soit au génome, les pseudogènes et les éléments régulateurs situés entre les gènes (promoteurs et inhibiteurs) qui servent à la transcription.
Ces découvertes nous amènent inévitablement à établir une surprenante inférence, source active d’énigmes et d’interrogations : seulement 3% de l’ADN, celui qui correspond à ce que l’on appelle généralement le « code génétique » contenu dans les chromosomes responsables de l’hérédité, est responsable de notre forme et de notre métabolisme, de notre identité de « vivant ». Quid de tout le reste, de la grande majorité de l’ADN, de ces « non-gènes », du JunkADN, de l’ADN non-codant ? Sont-ils réellement non-codant ? Manifestent-ils l’existence d’un code de la vie plus vaste, plus intégral ? Et si le junkADN n’est qu’un résidu, qu’un rebus, l’est-il seulement de l’histoire de l’évolution biologique ou renvoie-t-il à un autre processus qui pour le moment nous échappe ? S’il est parfois conçu comme un parasite ou un virus ─ un rétrovirus, faut-il le considérer exclusivement comme néfaste ou agit-il de façon plus ambivalente à la manière d’un pharmakon dont la logique et les enjeux mériteraient d’être recherchés ?
Concernant les fonctions et les implications de l’ensemble de ce domaine « noir » (car encore largement inconnu et peut-être déterminant pour comprendre la vie et le devenir, à l’instar de la « matière sombre » pour l’univers), à côté des actions positives (influence directe dans le processus génétique) et médicales (thérapies géniques) envisagées, et pour certaines vérifiées, par les scientifiques, les hypothèses ne manquent pas, dont les plus originales et les plus troublantes sont dues en particulier aux deux chercheurs que nous avons évoqués plus haut : Thierry Bardini et Jérémy Narby. Sans doute la puissance supposée accordée à l’ADN, liée aux différentes correspondances symboliques et figuratives (hélice, spirale, serpent, axis mundi) qu’elle possède avec d’importantes traditions et civilisations passées et présentes, occidentales ou non, vient-elle des métaphores cybernétiques et informationnelles (code, programme, langage, information, transmission, rétroaction) qui lui sont associées et qui contribuent à faire d’elle un possible médium universel. Reste en dernier lieu la question du message.
Signalons pour terminer qu’il existe une valeur heuristique du junk. Le déchet, le rebus et surtout le résidu (le tartre, les sédiments, les produits de la fermentation et de la corruption, le cadavre, les humeurs, les peaux mortes et autres traces du corps, etc.) possèdent une positivité dans les sciences expérimentales, dans la médecine, la pharmacie, la biologie, la minéralogie, la paléontologie, la criminologie, l’agronomie. Le junk est donc réintégré dans ces sciences et réévalué dans une perspective herméneutique, comme il l’est par ailleurs, cette fois-ci dans une perspective économique, dans les domaines de la récupération, du recyclage et du réemploi.
– Collectif, L’ivresse du réel – L’objet dans l’art du XXe siècle, R.M.N., 1993 (exposition, Carré d’art-Musée d’art contemporain, Nîmes).
– Pierre Restany, Nouveau Réalisme, 1960-1990, La Différence, 2007.
– Collectif, Le Nouveau Réalisme, R.M.N., 2007 (Exposition, Galeries Nationales Du Grand Palais, Paris, 28 Mars 2007-2 Juillet 2007).
– Gillian Whiteley, Junk : Art and the Politics of Trash, I. B. Tauris, 2011 (junk et art, en anglais).
– Rem Koolhass, Junkspace, Payot, 2011.
– Jeremy Narby, Le serpent cosmique, l’ADN et les origines du savoir, Georg, 1997.
– Junkware, Thierry Bardini, University of Minnesota Press, 2011 (en anglais).
– http://mirabilia.europa.over-blog.com/article-31642272.html (article de Bardini sur Rem Koolhass et le junk)
– http://commposite.org/index.php/revue/article/view/142/114 (entretien avec Thierry Bardini)
– http://vxheavens.com/lib/mtb00.html (article de Thierry Bardini sur l’hypervirus et le junk ; en anglais)
– http://www.culturalgangbang.com/2006/07/junk-dna-ergo-cogito.html (rappels de génétique et hypothèses sur junkADN)
– François Dagognet, Des détritus, des déchets, de l’abject, Les empêcheurs de penser en rond, 1997